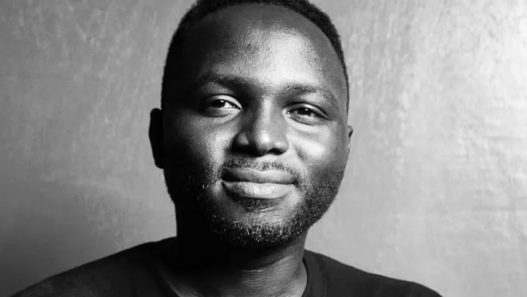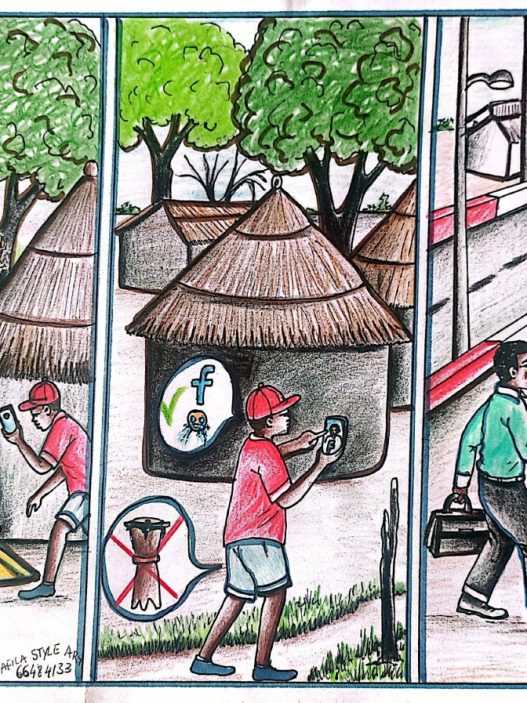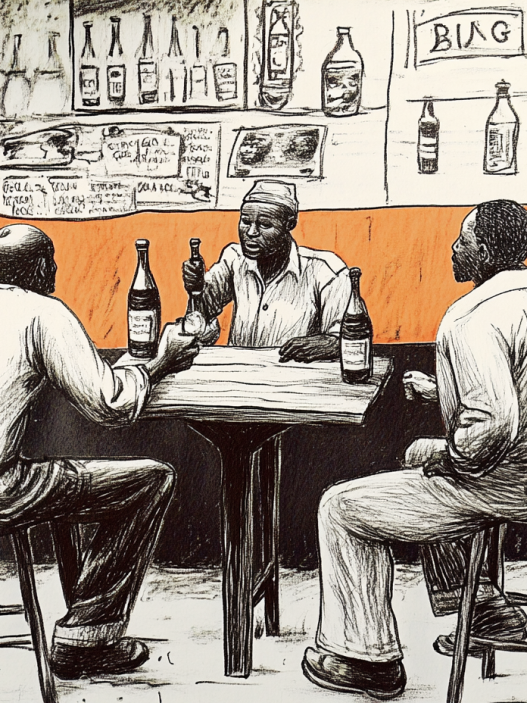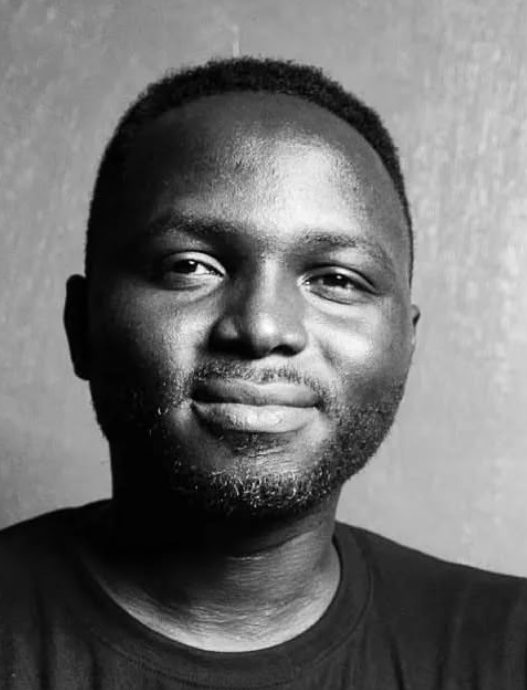Parler de ma famille, de mon ethnie ou de ma religion n’est pas dans mes habitudes. Je préfère me définir simplement comme Tchadien, une identité qui me semble bien plus rassembleuse.
Je suis né et j’ai grandi à Beinamar au sud du Tchad. Mon père, l’un des premiers intellectuels de la région, aujourd’hui décédé, repose dans la cour familiale au quartier « A ». Enfant, je parlais couramment le Foulbé et le Gorane, deux langues dont j’ai encore des notions aujourd’hui, car j’ai grandi avec ces deux communautés musulmanes.
Pour rappel, les Kilangs sont des Ngambayes issus du logone occidentale et du Mayo-Kebbi Ouest qui se distinguent dans leur parler avec les autres Ngambayes par une certaines intonnations différentes et quelques mots typiques à eux. Ils vivent de l’agriculture principalement et de petits élevages.

Je me souviens encore, tout petit, des images des Goranes rapatriés du Cameroun dans de gros camions. On les avait installés à Beinamar, localité frontalière avec le Cameroun. Le maire de la ville de l’époque, Monsieur Deounaye Nguissibé, qui était aussi mon père adoptif, leur avait attribué des terres pour s’établir, dont une grande parcelle appartenant à ma famille.
Ma sœur aînée a eu un enfant, une fille avec Rachidou, mon voisin de classe et ami d’origine Peulh. Ma nièce, élevée dans l’islam, a été mariée il y a un an selon les traditions musulmanes, on l’appelle Maïmouna.
C’est à Beinamar que j’ai commencé à jouer au football, que j’ai fait mes premiers pas à l’école… Nous y vivions en paix, aux côtés des Goranes, des Peuls et des Mbororos. Certains amis d’enfances Goranes avec lesquels j’ai grandi on s’appelle presque tous les jours jusqu’à ces jours. Y’en a qui portent fièrement des surnoms #Ngambaye (notre langue locale). Toutes les fois où je venais voir ma mère qui y vit toujours, elle fait appel à mes amis musulmans pour manger au domicile familiale ensemble.
Un jour, alors que j’étais très petit, des militaires venus de Moundou ou de N’Djamena ont fait irruption de nuit pour arrêter des militants de URD (un parti politique de l’opposition créer par Kamougué). Mon grand frère, Jean-Claude, a réussi à fuir et à se réfugier au Cameroun. Les autres, moins chanceux, ont été arrêtés, emmenés hors de la ville et exécutés. C’était mon premier traumatisme d’enfant. Parmi eux, il y avait des oncles, des cousins… Quand j’ai demandé à ma mère ce qu’ils avaient fait pour mériter un tel sort, elle m’a simplement répondu : « Ils étaient des opposants. »

Beinamar, zone enclavée du sud du Tchad, est un terreau d’exactions et d’injustices où les agents de renseignement et les autorités font leurs lois. Pourtant, c’est aussi une région fertile, l’un des greniers du Logone occidental.
Ayant grandi dans cette partie du pays où autochtones et autres Tchadiens cohabitent pacifiquement depuis des années, je peux affirmer sans hésitation que le vrai problème de ce village, ce sont ses autorités administratives.
Lorsque l’opposant Succès Masra a été arrêté, accusé d’être le commanditaire des événements tragiques de Mandakao à quelques kilomètres de Beinamar, j’ai appelé mes cousins au village. Leur réponse a été sans équivoque : « Mais qui connaît Masra à Mandakao ? »
L’État a les moyens de réprimer tout acteur politique. Mais instrumentaliser les clivages ethniques et religieux pour diviser les Tchadiens reste la pire chose qui puisse nous arriver.